L Shahid interdite de parole à l’École des Beaux-Arts de Marseille - J. Genet et la position du départ soudain
jeudi 20 janvier 2011 - 09h:07
Leïla Shahid - Autodafe n° 2 - Automne 2001
"Mettre à l’abri toutes les images du langage
et se servir d’elles, car elles sont dans le désert où il faut aller les chercher."
Jean Genet, exergue à Un captif amoureux
Palestine, on est prié de débattre ailleurs
Extension du domaine de la lutte, encore et encore.
Après Stéphane Hessel à l’École normale supérieure, c’est Leïla Shahid, déléguée générale de la Palestine auprès de l’Union européenne, qui s’est heurtée, mardi 18 janvier, à un refus de l’École des Beaux-Arts de Marseille. Elle devait s’exprimer dans un colloque consacré à Jean Genet, qui fut de son vivant un sympathisant affiché de la cause palestinienne et qu’elle côtoya (lire l’article de Leïla Shahid ci-dessous).
Comme à Normale Sup’, ce sont “les conditions de sécurité” qui ont été invoquées (avec l’ouverture au public de ce qui devait être une rencontre avec des étudiants) pour justifier l’annulation par la mairie de Marseille. Le colloque prévu, selon le quotidien La Provence, a trouvé refuge dans une salle de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Les colloques sur les gastéropodes rencontrent moins d’obstacles.
Jean Genet et la position du départ soudain
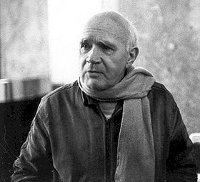
- Jean Genet (1910/1986)
Si le premier contact de Genet avec les Palestiniens, en 1970 et après les massacres de septembre, a été émotionnellement fort, c’est sûrement avec les femmes qu’il a eu le plus de complicité, de malice partagée, de communication réelle...
Les camps, c’est un peu la Palestine transportée par les Palestiniens dans leur exil. C’est leur vie, leur mémoire, le village qu’ils ont emmenés avec eux quand ils ont dû prendre la route après la destruction de leurs villages en 1948. Tous pensaient alors qu’ils partaient pour fuir les zones de combat, comme les réfugiés du Vietnam, du Cambodge ou du Salvador, et qu’ils reviendraient chez eux quelques mois après, lorsque la situation se serait calmée. Ils sont partis avec un baluchon et le minimum vital (souvent en emportant la clé de la maison, pensant qu’ils reviendraient bientôt). Et ils ne sont jamais revenus.
Dans cet exil perpétuel, dans ce départ, c’est toujours la femme qui a porté le plus de poids. Car c’est elle, dans la société arabe, qui tient la famille. Les hommes, eux, ont vécu l’exil comme la plus grande humiliation de leur histoire. C’étaient des paysans, et ils vivaient de leur terre. Et quand on prend la terre à un paysan, c’est comme si on le déshonorait, comme si on le castrait, on lui enlevait son âme.
Les femmes avaient une autre attitude. N’étant pas elles-mêmes celles qui cultivent, l’exil a été bien sûr une très grande tragédie, mais elles ont intériorisé la terre, le village, la culture. Elles ont appris à supporter la négation de leur identité, de leur nationalité. En intériorisant leur identité palestinienne et en la transportant avec elles dans les camps de réfugiés au Liban, en Syrie, en Jordanie, elles l’ont réinvestie dans d’autres formes d’expression, souvent culturelles, qui étaient un peu des racines les reliant à leur terre.
La broderie est une des formes de cette identité qu’elles ont intériorisée et qu’elles ont retraduite par des points de croix sur le tissu. Car à l’origine, la broderie était le plastron de la robe. Les femmes paysannes en Palestine portent de longues robes noires, bleu marine ou mauves. Et elles brodent déjà très tôt, car ce sont des robes qu’elles mettent pour leur mariage. Dès l’âge de douze ans, les filles collectionnent des fils de soie (le fil de soie qui vient de la Syrie coûte très cher). Ensuite, elles tissent la robe et commencent à broder. Elles brodent de douze ans jusqu’à leur mariage, qui a lieu à seize ou dix-sept ans, cette robe qu’elles porteront alors. Elles brodent aussi un coussin qui est un peu le symbole de la maison, du domicile conjugal.
Quand les femmes sont parties sur les routes de l’exil en 1948, elles sont parties avec leurs robes. Et bien sûr dans l’horreur de l’exil des camps, cette vie insalubre de bidonville, la tradition est presque morte. Car qui avait encore la possibilité de broder avec des fils de soie ? - la plupart du temps leur souci principal était de survivre.
Mais une grande partie des réfugiées a quand même réussi à recréer dans ces camps une petite Palestine, et c’est là que j’ai retrouvé ma Palestine, dans le camp de Chatila. Elle était presque plus forte que la vraie Palestine. Et c’est pour cela que je trouve tellement beau que Jean Genet dise dans les premières pages du Captif : "Qu’est-ce qui est plus vrai ? Le trait noir sur la page ou le blanc à côté ? " C’est-à-dire : qu’est-ce qui est plus fort ? - la Palestine, la terre elle-même, ou la patrie que tu as créée quand on t’enlève le droit de vivre sur cette terre ?
Dans cette Palestine recréée, il y avait une force que Jean Genet a sentie quand il est passé à Amman dans cet énorme camp de réfugiés qui s’appelle Wahdate, et dont Genet parle dans Un captif. Il a découvert, là, que les femmes avaient gardé leur humour, à l’inverse des hommes, complètement abattus par l’expérience de l’exil et de la dépossession de la terre. Quand tu entres dans un camp, les premières que tu trouves debout, la tête alerte et les épaules droites, ce sont les femmes, pas les hommes. Les hommes sont tous là avec les épaules courbées, le keffieh qui pend, ils ont l’air complètement figés, surtout les vieux. Les femmes sont très fortes, avec leurs fils à leurs côtés, les feddayins ; eux sont encore debout car ils ont un fusil, et d’une certaine manière, ce fusil leur rend une force que leur donnait la présence de la terre. Elles impressionnaient énormément Genet. Car elles ont une puissance, une dignité... Et personne n’a jamais parlé des femmes comme Genet - des femmes tout court, mais surtout des femmes du tiers-monde, des femmes pauvres. Car il les comprenait sans mots, il y avait une complicité entre elles et lui. Il faut dire qu’il ne parlait pas arabe, et elles ne parlaient pas français. Toute la communication entre lui et les Palestiniennes des camps de Jordanie passait donc par des clins d’ ?il. Lui les comprenait et elles, elles voyaient qu’il comprenait. Le plus extraordinaire, c’est que lui venait vers cet Orient (il ne faut pas oublier qu’il a grandi dans une école française du Morvan, il a fait son catéchisme, il a été enfant de ch ?ur ; il était imprégné de toute une culture judéo-chrétienne qui lui présentait l’Orient comme un grand mystère où les femmes sont voilées, et n’assument pas de responsabilité dans la société) et il arrive là, en 1970 en Jordanie, où il découvre que les vrais "hommes" sont les femmes. Elles sont là, elles sont fortes, prennent l’initiative, dirigent les hommes, alors qu’elles n’ont officiellement que la position de femmes !
Et il est très impressionné... mais je ne veux pas raconter Un captif amoureux, où elles sont décrites. Elles sont magnifiques, que ce soit par leur force face à l’armée jordanienne, ou par leur côté malicieux, démontant le sérieux des hommes et les "mettant en boîte", démystifiant leur virilité, se moquant d’eux et leur disant : "Celui-là, que tu prends pour un grand combattant, je l’ai torché, je l’ai lavé, je le connais, c’est moi qui l’ai sorti de mon ventre."
C’est donc par le biais des femmes qu’il a réellement rencontré les Palestiniens et s’est mis à les aimer. [...]
Mais je voudrais revenir à sa fascination pour la broderie. La première fois qu’il a revu des plastrons comme ceux des robes paysannes dans les camps d’Amman, c’était à Rabat. Car ma mère habitait chez moi à l’époque - elle est née en 1920 à Jérusalem, a vécu toute son enfance en Palestine, elle a été témoin de la lutte palestinienne contre le mandat et contre la création d’Israël, puisque son père était lui-même mêlé au mouvement nationaliste (il a d’ailleurs été arrêté et déporté par les Anglais pendant quatre ans). Or, ma mère était à Amman au moment de la guerre entre Israël et les pays arabes en 1967, et dans l’exode elle a vu des femmes en train de vendre leurs bracelets en or et leurs robes pour avoir de quoi survivre, en attendant que les Nations Unies amènent leurs camions de vivres pour les nourrir.
Et ma mère fut déchirée, voyant ces femmes vendre leurs robes, car c’était comme si elles perdaient encore une fois leurs racines, leur terre.
Rentrée à Beyrouth, elle a pris contact avec des équipes sociales qui s’occupaient des camps de réfugiés, et au lieu de faire les tricots habituels, elle leur a proposé de retrouver la tradition de la broderie nationale, de sauver la culture représentée dans le costume de la femme paysanne. Mais comme ces costumes prenaient des années à broder, elle a suggéré de faire de petits coussins carrés, dont le motif principal serait pris sur les robes. Elle a donc étudié avec ses s ?urs les motifs des robes achetées sur les routes de l’exil, et ces motifs sont millénaires. Chacun a une signification, un nom, ils évoquent un village, une contrée. Car l’idée n’était pas de faire uniquement de la broderie mais de faire vivre la culture palestinienne, de résister à la négation de leur identité.
C’est ainsi que Jean, assis à Rabat, voyait ma mère broder pendant des heures. (Ma mère a vécu toute la guerre de Palestine, toute la guerre du Liban. Elle a été exilée de Palestine et du Liban. Et la broderie était comme une thérapie. Chaque fois que tu piques l’aiguille dans le tissu, tu as l’impression de renouer avec quelque chose. Car le point de croix c’est comme un n ?ud. Cela a été sa manière de résister. Ma génération a résisté en faisant la révolution et sa génération a résisté en faisant de la broderie.) Et Jean, assis dans le salon de Rabat, se demandait ce que cette femme palestinienne faisait au Maroc, à recopier sur des coussins des motifs venant de plastrons que lui avait vus sur les seins des femmes palestiniennes dans les camps de Baqa et Wahdate. Il essayait de comprendre la relation entre les camps de réfugiés en Jordanie, mon salon à Rabat, et l’aiguille de ma mère brodant le tissu. Et cette histoire, cette vie que l’on brode (et on ne peut pas ne pas penser aux légendes grecques, au sens du fil d’Ariane, de la broderie de Pénélope, à la mémoire, à l’identité, au temps et à l’espace) devenait soudain pour lui très symbolique. Il avait établi avec ma mère, ma mère qui aurait dû, de par son origine sociale, l’agacer profondément (d’ailleurs il en parle de manière très touchante dans Un captif), une très belle relation car il retrouvait en elle la dignité. Il me parlait de ses épaules, il disait : "Qu’elle est belle, de dos", car il retrouvait en elle cette dignité des femmes qui ont su résister, chacune à sa manière, à la dépossession et à l’exil. Et il l’interrogeait sur ce qu’elle brodait, elle lui racontait l’histoire de la fabrication des robes. Il lui posait inlassablement des questions sur Jérusalem, sur son enfance, sur sa famille, sur l’histoire.
Or, en 1982, nous sommes allés à Beyrouth. Il avait oublié la broderie.
Il y avait une femme qui habitait chez nous car elle avait perdu son appartement. Cette femme, assise là, nous voyait courir dans tous les sens à cause de l’invasion de Beyrouth-Ouest, et elle voulait se rendre utile car elle se sentait un peu comme une intruse. Un jour, nous rentrons, Jean et moi, d’une de nos tournées en ville. L’immeuble où habite ma mère est maigre et long, il borde la mer et devant, il y a une grande avenue en pente. Nous arrivons en haut de la rue (du haut de laquelle on voit notre immeuble de douze étages), je lève les yeux... Que voit-on sur le balcon de l’appartement de ma mère au huitième étage ? Des dizaines et des dizaines de robes palestiniennes qui pendent sur la véranda. Et Jean me dit : "Regarde, Leila." Et on voit toutes ces robes qui pendent des fenêtres du balcon. On dégringole l’avenue et on monte les huit étages en criant : "Rentrez les robes, rentrez les robes." L’armée israélienne était en ville et les robes palestiniennes pendaient à la véranda. Je dis à cette femme : "Qu’est-ce que tu as fait ? Pourquoi les robes pendent au balcon ?" Et elle dit : "Je n’avais rien pour m’occuper. Vous êtes tous partis, vous m’avez laissée ici. J’ai trouvé toutes ces robes dans le coffre de ta mère dans sa chambre. Je me suis dit qu’il faudrait les aérer un peu, pour que les mites ne les “bouffent” pas." Et elle ne comprenait pas, bien sûr, que ces robes étaient comme des drapeaux, et que pour les Israéliens, dans leurs voitures des services de renseignements, voir toutes ces robes pendre, c’était comme si on avait déployé des drapeaux palestiniens.
Cette histoire a beaucoup amusé Jean, et il a saisi la relation entre les choses et la signification de ces broderies, qu’il avait vues d’abord sur les plastrons des femmes à Amman, puis dans le salon de ma mère à Rabat, puis retrouvées sur les balcons de Beyrouth, au moment où Beyrouth était envahie par l’armée israélienne.
Il voyait là une forme d’expression tellement plus subtile que celle des hommes, une forme de communication et de parole sur la Palestine qui ne passait pas par les discours politiques habituels. Et c’était en même temps un discours, la broderie, tout ce que l’on peut dire sur sa relation à sa terre, à son identité, à sa mémoire, mais cela ne passait pas par les mots évidents, mais des signes subtils, par la couleur, la symbolique esthétique. [...]
Ce qui fascinait Jean dans la broderie, c’était en fait le geste. Lorsqu’on pique le tissu, on fait un cercle. Et moi, tout le temps, à propos de sa vie, je disais : la boucle est bouclée ; la boucle de la vie de Jean est bouclée, elle commence quelque part à l’Assistance publique, elle passe par la révolte, la prison, elle va vers l’Orient quand il est soldat, elle retourne vers l’Orient avec les Palestiniens, et elle finit face aux cadavres qu’il trouve à ses pieds à Chatila.
Un captif amoureux, c’est aussi cela. C’est presque le tissage de sa vie. Dans ce livre, qui est avant tout un livre sur Genet mais aussi sur les Palestiniens, un livre sur tout ce qui a compté pour Genet, c’est comme s’il nous disait : "Je vous ai toujours menti. Ce n’est pas vrai que j’ai écrit parce qu’on m’a commandé des pièces." (Ce qu’il n’arrêtait pas de répéter.)
Et c’est très beau, cette idée que la broderie l’a inspiré pour la structure de son texte, car je crois que la mauvaise réception de ce livre vient de ce que les gens ne l’ont pas compris. Quand il a remis ce manuscrit à Gallimard, tout de suite les gens bien pensants, les critiques, les lecteurs, les directeurs de collection ont voulu savoir : "Qu’est-ce que c’est ? Un essai ? Une autobiographie ? Un reportage ? Un poème ?" Alors il les a beaucoup dérangés, car c’était ce que Jean appelle "le petit désordre dans l’ordre".
Et comme ils n’ont pas pu trouver une définition à coller sur ce texte, ils ont dit : "Ce n’est pas important. Ce n’est pas intéressant. Il est devenu sénile. C’est un texte où Genet se moque du monde." Ils n’ont pas compris que c’était juste le contraire. Genet, face à la mort, fait ce qu’il a refusé de faire pendant soixante-dix ans, il se met à nu, totalement, avec une limpidité, une transparence que je ne peux pas considérer autrement que mystique. [...]
Dans les images du tissage, du réseau, de la toile d’araignée, qui reviennent si souvent dans Un captif, on retrouve la manière particulière qu’avait Genet d’habiter le monde. Le jour où il est sorti de "taule", il a été à Damas, pour revenir à Paris. À Paris, il a été de nouveau en prison. Quand il est sorti de prison, il est parti en Allemagne, ensuite en Grèce, puis à Tanger, il est revenu à Paris, de Paris il est parti en Amérique, puis d’Amérique il est revenu à Amman, il est allé à Rabat, de Rabat à Beyrouth, et finalement à Paris. Il a passé sa vie à tisser sa vie, à travers des continents, des peuples, des cultures, des langues. Un va-et-vient incessant qui détruisait espace et temps, comme son livre.
Dans le nomadisme des Palestiniens en exil, il y a ce même itinéraire de déplacement perpétuel. Et c’est pour cela que ce sont les Palestiniens en exil qui l’ont fasciné, beaucoup plus que ceux qui sont restés sur leur terre.
Genet s’est toujours mis "en position de départ soudain" comme il le dit dans Chatila, afin d’abandonner la culture dans laquelle il était né, la langue dans laquelle il est né pour aller vers une autre. Car c’est dans l’entre-deux, dans le blanc entre les deux noirs, que sont les choses réelles. C’est dans la fissure que lui voyait la trace principale de la vie qui l’intéressait. Là où justement il y a quelque chose qui casse l’ordre. [...]
Et ça, c’est ce qu’il faudrait faire avec l’ ?uvre de Genet : s’inspirer du geste de Genet et ne pas nécessairement se conformer à une loyauté formelle au texte ou au message.
Dans Un captif, qui est un livre sur l’écriture et la création (et aussi sur les Panthers et les Palestiniens), il y a un trésor de propositions de création. Une création qui s’incruste dans la réalité du monde d’aujourd’hui. Avec les Noirs, les Blancs, les Palestiniens, les Arabes, l’islam, la chrétienté, avec le conformisme, la révolution... Ce n’est pas quelque chose qui se limite à une frontière nationale, ni à la cause des Palestiniens, ni à celle des Noirs d’Amérique, elle est universelle.
Et stupide celui qui croira qu’elle se limite à une seule frontière.
Dans ce va-et-vient, ce tissage, il y a l’univers entier. Le choix est ouvert à tout le monde. Il y a une invitation à l’écriture, à la création. Il y a quelque chose comme une longueur d’onde, qui se retrouve et passe à travers l’espace et le temps, faisant que la littérature, la musique, la peinture ont un langage commun qui dépasse les êtres humains dans leur vie quotidienne.
J’espère que d’autres feront preuve, avec Genet ou d’autres écrivains, du même courage pour créer des choses qui attendent là dans le néant, dans le désert. Comme le disait Jean tellement bien : "Mettre à l’abri toutes les images du langage et se servir d’elles, car elles sont dans le désert où il faut aller les chercher."
Cette phrase, je l’ai vue quand son ami Jacky m’a donné le manuscrit quelques heures après la mort de Jean. Et Jacky, qui connaît par c ?ur Genet et l’avait quitté la veille pour ne plus le revoir vivant, me dit : "C’est drôle, cette note manuscrite n’était pas là hier." Alors je regarde. Il y avait même dans les signes, le blanc sur la page, la fébrilité, sûrement le tremblement de la main de Jean qui était sur le point de mourir et qui avait besoin de mettre en exergue du Captif ces quelques lignes. Je les ai lues peut-être mille fois, en essayant de traverser ce mur de la mort qui nous sépare et en me disant : "Qu’est-ce qu’il a voulu nous dire ?"
Et maintenant nous parlons d’inventer, d’être à l’origine du nouveau, et soudain je comprends cette phrase encore différemment. Les images sont dans le désert où il faut aller les chercher. C’est un défi lancé à tous les créateurs : il faut toujours chercher ailleurs, là où il y a du désert.
 Leila Shahid : depuis novembre 2005, Leïla Shahid est déléguée générale de la Palestine auprès de l’Union Européenne à Bruxelles, fut longtemps responsable de La Revue d’études palestiniennes, a rencontré Jean Genet dans les années soixante-dix. En septembre 1982, lorsqu’elle part à Beyrouth - qui sort d’un siège de trois mois et où la situation semble alors calme -, Jean Genet décide, après dix ans d’absence, de l’accompagner. Sans s’en douter, ils arrivent à un moment crucial de la guerre libanaise, le massacre de Sabra et Chatila, dont Genet témoigne dans son article Quatre heures à Chatila, publié dans La Revue d’études palestiniennes. Leila Shahid a joué un rôle important dans l’écriture d’Un captif amoureux dont elle est l’une des "ardentes".
Leila Shahid : depuis novembre 2005, Leïla Shahid est déléguée générale de la Palestine auprès de l’Union Européenne à Bruxelles, fut longtemps responsable de La Revue d’études palestiniennes, a rencontré Jean Genet dans les années soixante-dix. En septembre 1982, lorsqu’elle part à Beyrouth - qui sort d’un siège de trois mois et où la situation semble alors calme -, Jean Genet décide, après dix ans d’absence, de l’accompagner. Sans s’en douter, ils arrivent à un moment crucial de la guerre libanaise, le massacre de Sabra et Chatila, dont Genet témoigne dans son article Quatre heures à Chatila, publié dans La Revue d’études palestiniennes. Leila Shahid a joué un rôle important dans l’écriture d’Un captif amoureux dont elle est l’une des "ardentes".


 Imprimer la page
Imprimer la page


